- SÉISMES ET SISMOLOGIE - Sismicité et tectonique des plaques
- SÉISMES ET SISMOLOGIE - Sismicité et tectonique des plaquesLe développement des réseaux de sismographes à l’échelle mondiale a rapidement montré que la sismicité n’était pas distribuée au hasard, mais qu’elle s’articulait le long de grandes lignes sismiques continues à la surface du globe. L’interprétation de ces données n’a pu être proposée de manière cohérente qu’avec le développement de la théorie de la tectonique des plaques [cf. TECTONIQUE DES PLAQUES]. En 1968, Bryan L. Isacks, Jack Oliver et Lynn R. Sykes montrent comment les observations sont bien expliquées par la nouvelle théorie, tant du point de vue de la répartition des séismes que de celui des mécanismes au foyer. Depuis le séisme de San Francisco (1906) et les travaux de Harry Fielding Reid, la relation entre les tremblements de terre et le jeu de failles est bien établie. L’essentiel des séismes a lieu au contact des grandes plaques lithosphériques, et c’est la nature de ce contact qui caractérisera la situation en matière de risque sismique. Le déplacement relatif de deux plaques adjacentes entraînera des déformations qui sont importantes pour évaluer le risque.1. La sismicitéMagnitudePour étudier de façon aussi quantitative que possible la sismicité du globe ou d’une région particulière et pour classer les séismes entre eux, on a cherché à définir une quantité, appelée magnitude, liée à l’énergie développée au foyer du séisme.L’échelle de magnitude (ou échelle de Richter, encore trop souvent confondue avec l’échelle des intensités) permet de comparer entre elles les énergies libérées dans les différents séismes. La magnitude est calculée à partir de la mesure de l’amplitude du mouvement du sol déterminée d’après l’enregistrement obtenu sur un sismographe standard à une distance donnée de l’épicentre. La magnitude M est liée à l’énergie E libérée au foyer du séisme par la formule approximative:
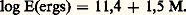 Un séisme de magnitude 3 correspond à une secousse ressentie sur une surface peu étendue; un séisme de magnitude 4,5 peut causer des dégâts légers; un séisme de magnitude 6 – celle du séisme de Skopje, en 1963 – entraîne des dégâts importants; le séisme de San Fernando, avec une magnitude de 6,6, a causé des dégâts évalués à 550 millions de dollars; les plus grands séismes enregistrés dans toutes les stations du globe ont une magnitude comprise entre 7 et 8,5; on estime que le séisme de plus forte magnitude – voisine de 9 – a été celui de Lisbonne, en 1755.La formule ci-dessus montre qu’un séisme de magnitude 8,5 est 100 millions de fois plus fort qu’un petit séisme de magnitude 3.Les zones sismiques du globeGrâce à l’augmentation du nombre et de la sensibilité des stations sismologiques, plusieurs milliers de séismes peuvent être étudiés chaque année. Pour la seule année 1981, le service sismologique américain a déterminé par ordinateur les coordonnées hypocentrales de 6 784 séismes: 5 255 d’entre eux avaient leur foyer à moins de 71 kilomètres de profondeur (foyers «normaux»), 1 304 à une profondeur comprise entre 71 et 300 kilomètres (foyers «intermédiaires»), 225 à une profondeur comprise entre 301 et 700 kilomètres (foyers «profonds»).Les cartes mondiales de sismicité se ressemblent beaucoup d’une année à l’autre: ce sont toujours les mêmes régions qui présentent la plus grande activité sismique. Cependant, régionalement ou localement, on observe des différences, les nouveaux foyers venant rarement occuper la place exacte des foyers plus anciens. De temps en temps, des séismes se produisent dans des régions inhabituelles; le séisme du 29 mars 1954, à 630 kilomètres de profondeur sous la sierra Nevada, en Espagne, en est un exemple classique, de même que celui de Guinée en décembre 1983.Les études de sismicité ont joué un rôle important dans la découverte de l’un des traits les plus remarquables du globe, le réseau mondial des rifts , et dans l’élaboration de la tectonique des plaques . Une première carte établie en 1954 (fig. 1) montrait l’existence d’une activité sismique continue le long de la partie médiane de l’océan Atlantique et de celle de l’océan Indien, du nord de l’Islande au golfe d’Aden et à la mer Rouge, dessinant les contours d’un bloc «Afrique», au sens large. Les travaux des équipes américaines conduisirent à penser que cette activité sismique médio-océanique était associée à l’existence d’un fossé fracturé, un rift, dont on put suivre le développement sur plus de 60 000 kilomètres de longueur. Le rift est une zone de distension favorisant la montée de roches magmatiques; d’importantes anomalies magnétiques, alternativement positives et négatives, se constatent de part et d’autre du rift. À partir de ces faits et en reprenant la vieille hypothèse de la dérive des continents , proposée en 1912 par Alfred Wegener et trop longtemps abandonnée, les auteurs de la nouvelle tectonique globale, ou tectonique des plaques, ont été conduits à envisager la Terre morcelée en un certain nombre de blocs, les plaques lithosphériques, dont les bords sont définis par les zones sismiques actives [cf. TECTONIQUE DES PLAQUES].Les cartes de sismicité, même établies pour une année seulement (fig. 2), montrent clairement les limites des principales plaques: Afrique, Eurasie, Australie, Pacifique intérieur, Nazca, Amérique, Antarctique.Les principales zones sismiques du globe comprennent:– Le cercle sismique circumpacifique , où se libère 80 p. 100 de l’énergie sismique totale; il est jalonné par l’arc des îles Aléoutiennes, le Kamtchatka, la guirlande des îles Kouriles, les côtes orientales des îles japonaises; la zone sismique se divise ensuite en deux branches, l’une passant par Formose et l’arc des Philippines, l’autre au contraire suivant, plus à l’est, la crête sous-marine marquée par les îles Bonin, Mariannes, Guam et les Carolines occidentales; les deux branches se rejoignent en Nouvelle-Guinée et le cercle se poursuit par les îles Salomon, les Nouvelles-Hébrides, les îles Fidji, Tonga et Kermadec, la Nouvelle-Zélande. Partout dans cette zone sismique, des foyers profonds et intermédiaires sont associés aux foyers normaux et se rangent sur des plans inclinés plongeant, sauf dans la région des Nouvelles-Hébrides, vers l’extérieur du Pacifique.Dans le sud-est du Pacifique, la zone sismique présente au contraire un autre caractère: elle est associée à un rift océanique qui, à partir des îles Balleny dans l’Antarctique, rejoint le golfe de Californie en passant par la crête de l’île de Pâques et les îles Galápagos; les séismes sont tous normaux.Une autre zone prend son origine dans les Antilles du Sud, remonte le long du littoral pacifique de l’Amérique du Sud et sous les Andes – où, à nouveau, séismes intermédiaires et profonds sont associés aux séismes normaux –, englobe la boucle des Antilles; par le Mexique, la Californie et l’Alaska, le cercle se referme dans les îles Aléoutiennes.– La zone transasiatique englobe tout le système orogénique alpin, depuis l’Espagne et l’Afrique du Nord jusqu’aux chaînes de l’Asie centrale; par la Birmanie et l’Indonésie, elle rejoint, dans la mer de Banda, le cercle circumpacifique.– Les rifts médio-océaniques de l’Atlantique et de l’océan Indien sont le siège de séismes fréquents uniquement superficiels et de magnitude généralement modérée.Sismicité de la FranceAucune région du globe n’est complètement dépourvue de séismes, mais, plus les mouvements orogéniques sont anciens, plus l’activité sismique est faible.La France fournit un bon exemple de régions sismiques différenciées en relation avec l’histoire tectonique de chaque région (fig. 3).Dans les plis pyrénéo-provençaux, les foyers se trouvent en général sur le «front nord-pyrénéen», grand accident tectonique qui forme le contact entre une profonde avant-fosse et les terrains secondaires fortement plissés de la chaîne pyrénéenne. Cette zone d’activité sismique se prolonge en Provence, où sont connus d’importants foyers sismiques.Dans le sud-est de la France (Alpes), de nombreux foyers jalonnent une zone de racines des plis alpins (arc briançonnais); d’autres épicentres intéressent les massifs subalpins en bordure du couloir rhodanien. En revanche, les massifs cristallins externes et la «fosse vocontienne» sont asismiques.Le socle hercynien en Bretagne, en Vendée, au détroit du Poitou, dans le Massif central et au sud-ouest des Vosges est le siège d’assez nombreuses secousses, en général d’intensité relativement faible; le socle s’est cassé suivant des lignes de fracture longues et profondes qui ont joué dès l’époque hercynienne et qui ont rejoué à l’époque tertiaire suivant les mêmes directions.Les fossés d’effondrement oligocènes (fossé rhénan, Limagnes) manifestent une activité sismique en relation avec les nombreuses failles qui, en profondeur, morcellent ces fossés.L’activité sismique des grands bassins sédimentaires (bassin de Paris, bassin d’Aquitaine) est très faible.Cartes de zones sismiquesSi les études de sismicité ont un aspect de science pure en dessinant les grands traits de la tectonique globale actuelle, elles ont aussi un caractère pratique, car elles permettent de délimiter les régions où des précautions doivent être prises pour assurer la protection de l’homme et de ses constructions.La confrontation des cartes d’épicentres, des cartes d’intensités maximales observées pendant une période aussi longue que possible et des cartes sismotectoniques – rendant possible en particulier l’identification des failles actives – conduit à tracer des cartes d’intensités maximales généralisées (fig. 3) qui fourniront à l’ingénieur et à l’architecte la documentation de base pour leurs calculs de protection parasismique [cf. SÉISMES ET SISMOLOGIE - Effets des séismes].Microsismicité et séismes artificielsPerfectionnés, en particulier pour les besoins de la détection des explosions nucléaires, les sismographes actuels, avec un grandissement qui peut atteindre 250 000 à 500 000, sont susceptibles d’enregistrer les très petits mouvements du sol. Des «réseaux de surveillance», comportant par exemple une dizaine de stations sismographiques dont les enregistrements sont envoyés par télétransmission à une station centrale, peuvent être rapidement installés dans les régions à étudier. On a ainsi pu mettre en évidence une activité sismique qui était autrefois passée inaperçue. Les coordonnées focales de nombreux séismes de faible magnitude, inférieure à 3, ont pu être calculées avec une précision inférieure à 500 mètres en longitude et latitude et de l’ordre du kilomètre en profondeur, permettant une interprétation sismotectonique plus cohérente.La figure 4 est relative à une campagne d’enregistrements effectuée dans le Queyras et dans la haute vallée de l’Ubaye en 1977: en un mois, plus de 1 500 séismes y ont été enregistrés; 192 ont été correctement localisés; 2 seulement avaient été ressentis par la population. La répartition des foyers confirme l’activité de l’arc sismique briançonnais évoqué plus haut et connu par les études macrosismiques.L’étude des répliques qui accompagnent les grands séismes a bénéficié également de l’amélioration de l’appareillage. La figure 5 montre la localisation de 865 répliques du séisme d’El-Asnam (10 oct. 1980) survenues entre le 15 novembre et le 2 décembre 1980; on notera que peu de foyers se trouvent au voisinage immédiat de la faille qui est apparue sur le terrain sur une longueur de 40 kilomètres au moment du séisme principal dont la magnitude avait atteint 7,3.L’augmentation de la sensibilité des appareils amène aussi les stations sismologiques à enregistrer de nombreux séismes artificiels, difficiles souvent à distinguer des séismes naturels: tirs de carrières, coups de toit dans certaines mines (bassin de Fuveau-Gardanne, mines de potasse en Alsace et en Allemagne, etc.), explosions nucléaires; pour la seule année 1981, les bulletins du service sismologique américain contiennent les coordonnées épicentrales de 39 tirs nucléaires: 16 au Nevada, 12 au champ de tir du Kazakhstan oriental, 6 en diverses autres régions de l’Union soviétique et 5 à Mururoa (Polynésie française).Une catégorie de séismes artificiels est particulièrement intéressante, celle des séismes induits par l’exploitation de gisements pétrolifères (Lacq, en France) et par le remplissage de certains lacs-réservoirs; dans ce dernier cas, les séismes ont pu atteindre des magnitudes supérieures à 5 et causer des dégâts aux habitations voisines et même au barrage lui-même (Koyna, en Inde, 1963). Plus que l’influence du poids de l’eau du réservoir, le phénomène principal est dû à la pénétration de l’eau en profondeur et à l’augmentation de la pression interstitielle dans des couches poreuses au voisinage d’un accident tectonique jusque-là inactif.Prévision des séismesL’étude de la sismicité régionale et le tracé des zones sismiques permettent de prévoir les régions où se produiront des séismes importants; l’étude systématique de la répartition des épicentres montre que, dans les grandes régions sismiques, des zones calmes (gap ) existent entre les zones d’activité récente: ce sont ces zones actuellement calmes qui présentent le plus de risques dans un avenir plus ou moins proche; leur surveillance par les différentes méthodes géophysiques est donc prioritaire.De vastes programmes de recherches ont été proposés dans plusieurs pays, Japon, États-Unis, Union soviétique, Chine: relevé des failles, enregistrement des déformations du sol, mesure des déplacements lents et continus (creep ) qu’on observe le long de certaines grandes failles de coulissage et qui peuvent atteindre quelques centimètres par an, révision périodique des polygones de nivellement, mesure du flux de chaleur, étude de la variation séculaire du champ magnétique terrestre et levés détaillés sur le terrain des composantes du champ, enregistrement des courants telluriques, mise en évidence d’anomalies de conductivité électrique.On a fondé beaucoup d’espoir dans l’enregistrement par des «réseaux de surveillance» (cf. supra : Microsismicité et séismes artificiels ) des faibles chocs pouvant constituer des signes prémonitoires d’un séisme plus important. En fait, un grand séisme n’est généralement pas précédé de telles secousses. Un exemple récent en a été fourni par le séisme du 29 février 1980, de magnitude 5, qui a entraîné des dégâts dans la zone épicentrale au voisinage d’Arudy (Pyrénées-Atlantiques): le réseau de surveillance installé dans les Pyrénées a, dans les mois qui ont précédé le séisme de 1980, enregistré de nombreux microchocs dans la région d’Arette où s’était produit le séisme destructeur du 13 août 1967, mais aucun dans celle d’Arudy, 25 kilomètres plus à l’est; c’est cette absence d’activité (gap ) qui aurait dû être prise en compte pour une prévision.Cependant, dans les rares cas où de nombreuses secousses prémonitoires faibles (essaims ) ont été enregistrées, une méthode de prévision fondée sur l’étude de la variation du rapport des vitesses des ondes P et des ondes S, variation due au phénomène de dilatance , a pu être expérimentée avec succès aux États-Unis en 1973.Aux méthodes classiques rappelées plus haut les Chinois ajoutent – grâce à la collaboration de plus de cent mille sismologues amateurs – l’observation de phénomènes précurseurs tels que bruits souterrains, comportement anormal des animaux (rats, serpents, oiseaux, chiens...), variations du niveau de l’eau dans certains puits, augmentation de la teneur en radon de l’eau de la nappe phréatique. Grâce à l’interprétation systématique et continue des données rassemblées, les sismologues chinois ont réussi la prévision spectaculaire du séisme (de magnitude 7,3) qui s’est produit dans la province de Liaoning le 4 février 1975: l’ordre d’alerte et d’évacuation a pu être donné 5 heures et 36 minutes avant le choc destructeur.Un an plus tard, malheureusement, la catastrophe du 27 juillet 1976 dans la région de Tangshan, faisant plus de 600 000 morts, est venue rappeler que le moment où l’on pourra formuler une prévision sûre et précise est encore fort éloigné. L’annonce, faite en 1980, que trois violents séismes devaient l’année suivante affecter dangereusement la région de Lima, au Pérou, ne s’est pas réalisée, mais a entretenu chez les habitants un sentiment d’angoisse généralisé et causé des pertes sensibles à l’économie nationale. Certains sismologues, aux États-Unis en particulier, se demandent aujourd’hui s’il est important de prévoir les séismes et si les accidents de circulation provoqués par la panique et l’évacuation de grandes cités ne causeraient pas plus de victimes que celles qui seraient dues au séisme lui-même; en ce qui concerne les dégâts matériels, le gain réalisé pourrait être annulé par les conséquences économiques qu’entraînerait l’évacuation des villes.Ainsi la seule mesure efficace reste aujourd’hui, et pour longtemps encore, le perfectionnement des constructions parasismiques et l’application stricte d’une réglementation de ces constructions.2. Les différents types de limites de plaquesDorsales océaniquesLe cas le plus simple est celui des dorsales océaniques. La sortie de matière chaude provenant de l’intérieur et son refroidissement engendrent des contraintes d’extension. Des failles normales sont disposées symétriquement par rapport à l’axe de la dorsale. La sismicité est superficielle et la magnitude n’excède pas 6.Dans quelques cas, les dorsales émergent (Djibouti, Islande). Il est alors possible de les étudier de près. Le réseau sismologique déployé dans la région de Djibouti a permis de connaître la sismicité dans cette zone et même d’étudier une crise sismique associée à une éruption fissurale.Dans d’autres cas, la croûte continentale n’est pas complètement séparée, le processus n’ayant pas encore abouti ou étant stoppé (fossé rhénan).Failles transformantesEn général on appelle failles transformantes les grands décrochements qui relient deux segments de dorsales ou deux régions de subduction. Elles correspondent aux limites de deux plaques où le déplacement relatif s’effectue parallèlement à la frontière commune. Des exemples caractéristiques sont fournis par la faille de San Andreas en Californie ou les failles d’El Pilar et de Boconó au Venezuela. La sismicité y est superficielle, ne dépassant pas une profondeur de 15 à 20 kilomètres, et elle indique bien que les surfaces de rupture sont plutôt verticales. Néanmoins, on peut trouver des situations plus complexes si la faille change de direction. C’est le cas de la faille de San Andreas, au nord de Los Angeles. Le changement de direction y produit un blocage de la faille et des contraintes de type compressif, responsables des tremblements de terre de San Fernando (1971, MS = 6,4) du côté ouest et de Kern County (1956, MS = 7,6) à l’est, mettant en jeu l’un et l’autre des failles inverses. Au contraire, si le changement se fait dans la direction opposée, le coulissage conservant le même sens le long de la faille, des pull-apart basins ou bassins en extension apparaissent, comme ceux qui sont connus le long de la faille de Boconó.Une autre source de complexité peut être trouvée en cas de ramification de la faille, comme cela se produit dans la région de San Francisco au nord de Hollister, ou bien lorsque la faille de Boconó se divise en trois branches au sud de Mérida, le mouvement total entre plaques étant alors distribué sur les différents éléments.Mais la propriété la plus remarquable concernant les grands séismes est qu’ils semblent avoir lieu d’une façon systématique et régulière sur les mêmes tronçons de la faille. C’est ainsi que la notion de tremblement de terre caractéristique devient importante dans les estimations du risque sismique.Convergence de plaquesConvergence océan-océanLe cas le plus simple de convergence entre plaques est celui de deux lithosphères océaniques. La sismicité permet de définir l’interface suivant laquelle s’effectue le déplacement (plan de Benioff). Pour ce type de convergence, l’angle de subduction est supérieur à 50 0. Dans quelques cas, la sismicité se présente sous forme de deux plans parallèles, l’un correspondant à l’interface proprement dite, l’autre étant situé à l’intérieur de la plaque plongeante. Les mécanismes au foyer varient le long de la subduction en profondeur, correspondant successivement à une déformation extensive due à la flexion de la plaque avant sa plongée près de la fosse, puis à la friction contre la plaque chevauchante, produisant des séismes de magnitude en général très élevée, et enfin aux effets gravitationnels de la plaque plongeant dans un milieu moins dense. Une activité sismique de faible profondeur est associée aux arcs insulaires [cf. ARCS INSULAIRES].Un exemple de convergence océan-océan est donné par la subduction caraïbe, où la plaque atlantique disparaît pour partie sous la plaque caraïbe. La vitesse de convergence varie suivant les auteurs entre 2 et 3,5 cm/an. Une lacune de sismicité développée depuis le dernier grand séisme de cette région en 1843 pourrait être le site d’un nouveau séisme de magnitude au moins égale à 8.Convergence océan-continentDans le cas de la convergence océan-continent, la situation est un peu plus complexe que dans le cas précédent. L’océan s’enfonce cette fois sous un continent plus léger, et le pendage de la subduction est en général moins accentué (de l’ordre de 450). Un cas typique est celui de la subduction de la plaque Nazca (Pacifique est) sous l’Amérique du Sud avec deux situations distinctes: d’une part, une subduction à angle normal, avec un volcanisme associé, d’autre part, une subduction présentant un pendage très faible, et sans volcanisme. La première correspond à la région du sud du Pérou (Arequipa), la seconde à la région du Pérou central, à la hauteur de Lima-Huancayo. La sismicité la plus importante se trouve au contact des deux plaques. Là ont lieu les grands tremblements de terre avec des fractures qui atteignent la surface, au niveau de la fosse. Une sismicité crustale se trouve associée à la formation des Andes, avec des failles normales le long de la flexure de la croûte continentale, et des failles inverses sur les flancs de la chaîne de montagne.Collision continent-continentIl n’y a pas de subduction dans le cas de la collision continent-continent, car la croûte continentale, plus légère, ne peut s’enfoncer dans le manteau. C’est la situation la plus complexe puisqu’il n’y a plus de limite de plaques linéaire où se concentre le mouvement relatif des plaques, mais au contraire la déformation s’étend sur de vastes régions, parfois à grande distance des ceintures ophiolitiques, témoins de l’ancienne croûte océanique qui séparait les plaques maintenant jointives. On parle ainsi de déformation plastique avec des failles inverses, des plis, des grands décrochements et des failles normales (cf. CHAÎNES DE MONTAGNES Typologie).Un exemple type est celui de la collision Europe-Afrique, contrôlée, selon Paul Tapponnier, par deux promontoires du continent africain: l’Arabie et l’Italie (fig. 6). L’Arabie agit comme un poinçon qui déforme l’Eurasie en formant la chaîne du Caucase et en éjectant latéralement l’Iran et la Turquie le long de la faille nord-anatolienne en décrochement dextre. De son côté, l’Italie s’écrase contre l’Europe le long des Alpes et contribue à la formation des Carpates. Le comportement en poinçon ou en écrasement dépend du sens de la subduction qui a précédé la collision. La croûte qui se déforme le plus est celle qui a les propriétés mécaniques les moins rigides du fait de la chaleur produite par la friction au contact des deux plaques s’affrontant, donc celle sous laquelle est dirigée la subduction avant la collision. Dans le cas de l’affrontement Europe-Afrique, une partie de la convergence reste océanique (l’arc égéen), mais la plupart des éléments tectoniques sont caractéristiques de la collision continentale. La sismicité est distribuée tout autour de la Méditerranée. Il n’y a pas de séisme dépassant une magnitude de 7,5 d’après les données historiques.Des exemples de la multiplicité des failles mises en jeu au cours de cette collision peuvent être trouvés au sud de l’Espagne et en Afrique du Nord, avec des plis, des failles inverses, normales ou en décrochement, mais le tout compatible avec des contraintes régionales ayant un axe de compression nord-nord-ouest - sud-sud-est. C’est dans cette région que s’est produit le séisme d’El-Asnam (1980, MS = 7,3), provoqué par le rejeu d’une faille inverse présentant une composante décrochante.3. La source sismiqueUn sismogramme porte essentiellement deux types d’informations liés l’un à la propagation des ondes sismiques du foyer au point d’observation, l’autre au processus de rupture à la source sismique. Celle-ci est étudiée maintenant activement pour comprendre comment les séismes se développent, pour estimer les mouvements forts au voisinage du foyer et pour fixer les normes de réalisation des habitations et constructions à haut risque (barrages, centrales nucléaires).Les tremblements de terre se produisent dans la partie fragile de la lithosphère. Le modèle de rebondissement élastique de H. F. Reid, construit à partir des observations géodésiques avant et après le séisme de San Francisco en 1906, est maintenant généralement admis: le mouvement relatif de deux plaques lithosphériques entraîne une déformation lente à faible distance de leur frontière avec accumulation continue de contraintes au niveau de la surface de contact qui cédera brutalement lorsque ces contraintes dépasseront la limite de résistance à la rupture des matériaux. Les données géodésiques permettent également de constater qu’en profondeur les matériaux fluent, concentrant les contraintes tectoniques dans la partie supérieure cassante de la croûte terrestre. Au cours d’un tremblement de terre, c’est donc seulement une zone superficielle très peu épaisse qui glisse de façon discontinue, l’ensemble de la Terre réagissant élastiquement. Il paraît aussi bien acquis que ce sont les parties affaiblies par des fractures anciennes qui vont rejouer préférentiellement.Si les causes des séismes sont assez bien expliquées pour leur plus grande part par la tectonique des plaques, le mécanisme de la rupture est encore l’objet de recherches très actives. Le faible nombre de données, particulièrement en champ proche, impose de modéliser la source sismique avec des modèles très simples dépendant d’un petit nombre de paramètres.On considère que les processus anélastiques ne concernent qu’une zone réduite autour du foyer et que la radiation des ondes sismiques résulte des contraintes équivalentes nécessaires pour produire les déformations dans les zones, extérieures à la source, où les lois de l’élasticité sont vérifiées: on appelle densité de moment sismique le tenseur des contraintes équivalent. Les sismologues utilisent généralement un modèle de double couple sans moment pour caractériser les sources sismiques. Dans la plupart des applications, l’approximation d’une source ponctuelle est suffisante, surtout lorsqu’on s’intéresse à des périodes de quelques secondes ou dizaines de secondes.Pour expliquer les observations sismiques, les sismologues introduisent des modèles simples. Dans le modèle de boucle de dislocation, le séisme est simulé par une discontinuité du déplacement de part et d’autre d’un plan de faille et sur une surface géométriquement simple (rectangle ou cercle). C’est un modèle essentiellement cinématique, où la dynamique de la rupture est négligée et où n’intervient que l’évolution dans le temps du glissement. Cette solution est incompatible avec la mécanique des milieux continus puisqu’il y a pénétration de la matière sur les bords de la surface de dislocation.Aussi les modèles dynamiques commencent-ils à être développés en s’appuyant sur la mécanique de la rupture des roches: une fissure en cisaillement se propage à partir d’un noyau, à relativement grande vitesse, en libérant les contraintes exercées sur la surface jusqu’à une valeur résiduelle, la friction. La fracturation se poursuit lorsque la contrainte en bout de fissure dépasse un niveau fixé suivant un critère objectif: on considère que l’énergie accumulée élastiquement doit être au moins égale à celle qui est nécessaire à la création de nouvelles surfaces. Dans un milieu homogène, uniformément contraint, la fissure se propage indéfiniment. Il faut un mécanisme d’arrêt, par exemple l’existence d’hétérogénéités locales de la résistance à la rupture du matériau (barrières) ou du champ de contrainte (aspérités). L’arrêt brutal de la rupture engendre de fortes ondes sismiques à l’intérieur de la fissure qui vont stopper le développement du glissement. Comme le jeu d’une faille se fait sous forte contrainte normale en compression, la friction va empêcher l’inversion de sens du glissement qui pourra se faire par saccades successives.L’hétérogénéité introduite pour stopper la rupture dans ces modèles de sources dynamiques permet d’expliquer la complexité observée sur les sismogrammes des grands séismes ou celle de la distribution spatiale des répliques localisées avec précision par des réseaux portables de sismomètres installés après des chocs majeurs: le tremblement de terre d’El-Asnam le 10 octobre 1980 est l’exemple d’un séisme complexe comprenant une succession de trois chocs, affectant des parties différentes de la faille. Keiiti Aki a proposé un modèle avec des zones à plus grande résistance à la rupture appelées barrières. Lorsque le front de rupture atteint cette barrière, la vitesse de propagation est ralentie ou même annulée, la rupture pouvant reprendre au-delà, laissant intacte une partie de la faille qui pourra céder lors de répliques ultérieures. Hiroo Kanamori a introduit un modèle avec des aspérités, les zones où se concentrent les contraintes dues à des séismes antérieurs ou à un glissement asismique (fluage par exemple). On peut considérer aussi un modèle mixte à partir de ces deux types de base. Ces modèles permettent d’expliquer pourquoi le relâchement des contraintes observé après les séismes est si faible (10 à 100 bars), alors que les mesures de laboratoires conduisent à des valeurs dépassant 1 kilobar pour obtenir la fracturation. La chute de contrainte mesurée par les sismologues serait une moyenne calculée sur l’intégralité de la faille et non pas sur les zones significatives considérées dans les modèles avec barrières ou aspérités. Trop peu de données sont actuellement disponibles pour permettre de progresser plus rapidement dans la compréhension du mécanisme des processus à la source des séismes. Des réseaux plus nombreux de sismomètres et d’accéléromètres (appareil de mesure des mouvements forts dans les zones sismiques) sont indispensables pour progresser dans la prévention et la prévision des séismes.
Un séisme de magnitude 3 correspond à une secousse ressentie sur une surface peu étendue; un séisme de magnitude 4,5 peut causer des dégâts légers; un séisme de magnitude 6 – celle du séisme de Skopje, en 1963 – entraîne des dégâts importants; le séisme de San Fernando, avec une magnitude de 6,6, a causé des dégâts évalués à 550 millions de dollars; les plus grands séismes enregistrés dans toutes les stations du globe ont une magnitude comprise entre 7 et 8,5; on estime que le séisme de plus forte magnitude – voisine de 9 – a été celui de Lisbonne, en 1755.La formule ci-dessus montre qu’un séisme de magnitude 8,5 est 100 millions de fois plus fort qu’un petit séisme de magnitude 3.Les zones sismiques du globeGrâce à l’augmentation du nombre et de la sensibilité des stations sismologiques, plusieurs milliers de séismes peuvent être étudiés chaque année. Pour la seule année 1981, le service sismologique américain a déterminé par ordinateur les coordonnées hypocentrales de 6 784 séismes: 5 255 d’entre eux avaient leur foyer à moins de 71 kilomètres de profondeur (foyers «normaux»), 1 304 à une profondeur comprise entre 71 et 300 kilomètres (foyers «intermédiaires»), 225 à une profondeur comprise entre 301 et 700 kilomètres (foyers «profonds»).Les cartes mondiales de sismicité se ressemblent beaucoup d’une année à l’autre: ce sont toujours les mêmes régions qui présentent la plus grande activité sismique. Cependant, régionalement ou localement, on observe des différences, les nouveaux foyers venant rarement occuper la place exacte des foyers plus anciens. De temps en temps, des séismes se produisent dans des régions inhabituelles; le séisme du 29 mars 1954, à 630 kilomètres de profondeur sous la sierra Nevada, en Espagne, en est un exemple classique, de même que celui de Guinée en décembre 1983.Les études de sismicité ont joué un rôle important dans la découverte de l’un des traits les plus remarquables du globe, le réseau mondial des rifts , et dans l’élaboration de la tectonique des plaques . Une première carte établie en 1954 (fig. 1) montrait l’existence d’une activité sismique continue le long de la partie médiane de l’océan Atlantique et de celle de l’océan Indien, du nord de l’Islande au golfe d’Aden et à la mer Rouge, dessinant les contours d’un bloc «Afrique», au sens large. Les travaux des équipes américaines conduisirent à penser que cette activité sismique médio-océanique était associée à l’existence d’un fossé fracturé, un rift, dont on put suivre le développement sur plus de 60 000 kilomètres de longueur. Le rift est une zone de distension favorisant la montée de roches magmatiques; d’importantes anomalies magnétiques, alternativement positives et négatives, se constatent de part et d’autre du rift. À partir de ces faits et en reprenant la vieille hypothèse de la dérive des continents , proposée en 1912 par Alfred Wegener et trop longtemps abandonnée, les auteurs de la nouvelle tectonique globale, ou tectonique des plaques, ont été conduits à envisager la Terre morcelée en un certain nombre de blocs, les plaques lithosphériques, dont les bords sont définis par les zones sismiques actives [cf. TECTONIQUE DES PLAQUES].Les cartes de sismicité, même établies pour une année seulement (fig. 2), montrent clairement les limites des principales plaques: Afrique, Eurasie, Australie, Pacifique intérieur, Nazca, Amérique, Antarctique.Les principales zones sismiques du globe comprennent:– Le cercle sismique circumpacifique , où se libère 80 p. 100 de l’énergie sismique totale; il est jalonné par l’arc des îles Aléoutiennes, le Kamtchatka, la guirlande des îles Kouriles, les côtes orientales des îles japonaises; la zone sismique se divise ensuite en deux branches, l’une passant par Formose et l’arc des Philippines, l’autre au contraire suivant, plus à l’est, la crête sous-marine marquée par les îles Bonin, Mariannes, Guam et les Carolines occidentales; les deux branches se rejoignent en Nouvelle-Guinée et le cercle se poursuit par les îles Salomon, les Nouvelles-Hébrides, les îles Fidji, Tonga et Kermadec, la Nouvelle-Zélande. Partout dans cette zone sismique, des foyers profonds et intermédiaires sont associés aux foyers normaux et se rangent sur des plans inclinés plongeant, sauf dans la région des Nouvelles-Hébrides, vers l’extérieur du Pacifique.Dans le sud-est du Pacifique, la zone sismique présente au contraire un autre caractère: elle est associée à un rift océanique qui, à partir des îles Balleny dans l’Antarctique, rejoint le golfe de Californie en passant par la crête de l’île de Pâques et les îles Galápagos; les séismes sont tous normaux.Une autre zone prend son origine dans les Antilles du Sud, remonte le long du littoral pacifique de l’Amérique du Sud et sous les Andes – où, à nouveau, séismes intermédiaires et profonds sont associés aux séismes normaux –, englobe la boucle des Antilles; par le Mexique, la Californie et l’Alaska, le cercle se referme dans les îles Aléoutiennes.– La zone transasiatique englobe tout le système orogénique alpin, depuis l’Espagne et l’Afrique du Nord jusqu’aux chaînes de l’Asie centrale; par la Birmanie et l’Indonésie, elle rejoint, dans la mer de Banda, le cercle circumpacifique.– Les rifts médio-océaniques de l’Atlantique et de l’océan Indien sont le siège de séismes fréquents uniquement superficiels et de magnitude généralement modérée.Sismicité de la FranceAucune région du globe n’est complètement dépourvue de séismes, mais, plus les mouvements orogéniques sont anciens, plus l’activité sismique est faible.La France fournit un bon exemple de régions sismiques différenciées en relation avec l’histoire tectonique de chaque région (fig. 3).Dans les plis pyrénéo-provençaux, les foyers se trouvent en général sur le «front nord-pyrénéen», grand accident tectonique qui forme le contact entre une profonde avant-fosse et les terrains secondaires fortement plissés de la chaîne pyrénéenne. Cette zone d’activité sismique se prolonge en Provence, où sont connus d’importants foyers sismiques.Dans le sud-est de la France (Alpes), de nombreux foyers jalonnent une zone de racines des plis alpins (arc briançonnais); d’autres épicentres intéressent les massifs subalpins en bordure du couloir rhodanien. En revanche, les massifs cristallins externes et la «fosse vocontienne» sont asismiques.Le socle hercynien en Bretagne, en Vendée, au détroit du Poitou, dans le Massif central et au sud-ouest des Vosges est le siège d’assez nombreuses secousses, en général d’intensité relativement faible; le socle s’est cassé suivant des lignes de fracture longues et profondes qui ont joué dès l’époque hercynienne et qui ont rejoué à l’époque tertiaire suivant les mêmes directions.Les fossés d’effondrement oligocènes (fossé rhénan, Limagnes) manifestent une activité sismique en relation avec les nombreuses failles qui, en profondeur, morcellent ces fossés.L’activité sismique des grands bassins sédimentaires (bassin de Paris, bassin d’Aquitaine) est très faible.Cartes de zones sismiquesSi les études de sismicité ont un aspect de science pure en dessinant les grands traits de la tectonique globale actuelle, elles ont aussi un caractère pratique, car elles permettent de délimiter les régions où des précautions doivent être prises pour assurer la protection de l’homme et de ses constructions.La confrontation des cartes d’épicentres, des cartes d’intensités maximales observées pendant une période aussi longue que possible et des cartes sismotectoniques – rendant possible en particulier l’identification des failles actives – conduit à tracer des cartes d’intensités maximales généralisées (fig. 3) qui fourniront à l’ingénieur et à l’architecte la documentation de base pour leurs calculs de protection parasismique [cf. SÉISMES ET SISMOLOGIE - Effets des séismes].Microsismicité et séismes artificielsPerfectionnés, en particulier pour les besoins de la détection des explosions nucléaires, les sismographes actuels, avec un grandissement qui peut atteindre 250 000 à 500 000, sont susceptibles d’enregistrer les très petits mouvements du sol. Des «réseaux de surveillance», comportant par exemple une dizaine de stations sismographiques dont les enregistrements sont envoyés par télétransmission à une station centrale, peuvent être rapidement installés dans les régions à étudier. On a ainsi pu mettre en évidence une activité sismique qui était autrefois passée inaperçue. Les coordonnées focales de nombreux séismes de faible magnitude, inférieure à 3, ont pu être calculées avec une précision inférieure à 500 mètres en longitude et latitude et de l’ordre du kilomètre en profondeur, permettant une interprétation sismotectonique plus cohérente.La figure 4 est relative à une campagne d’enregistrements effectuée dans le Queyras et dans la haute vallée de l’Ubaye en 1977: en un mois, plus de 1 500 séismes y ont été enregistrés; 192 ont été correctement localisés; 2 seulement avaient été ressentis par la population. La répartition des foyers confirme l’activité de l’arc sismique briançonnais évoqué plus haut et connu par les études macrosismiques.L’étude des répliques qui accompagnent les grands séismes a bénéficié également de l’amélioration de l’appareillage. La figure 5 montre la localisation de 865 répliques du séisme d’El-Asnam (10 oct. 1980) survenues entre le 15 novembre et le 2 décembre 1980; on notera que peu de foyers se trouvent au voisinage immédiat de la faille qui est apparue sur le terrain sur une longueur de 40 kilomètres au moment du séisme principal dont la magnitude avait atteint 7,3.L’augmentation de la sensibilité des appareils amène aussi les stations sismologiques à enregistrer de nombreux séismes artificiels, difficiles souvent à distinguer des séismes naturels: tirs de carrières, coups de toit dans certaines mines (bassin de Fuveau-Gardanne, mines de potasse en Alsace et en Allemagne, etc.), explosions nucléaires; pour la seule année 1981, les bulletins du service sismologique américain contiennent les coordonnées épicentrales de 39 tirs nucléaires: 16 au Nevada, 12 au champ de tir du Kazakhstan oriental, 6 en diverses autres régions de l’Union soviétique et 5 à Mururoa (Polynésie française).Une catégorie de séismes artificiels est particulièrement intéressante, celle des séismes induits par l’exploitation de gisements pétrolifères (Lacq, en France) et par le remplissage de certains lacs-réservoirs; dans ce dernier cas, les séismes ont pu atteindre des magnitudes supérieures à 5 et causer des dégâts aux habitations voisines et même au barrage lui-même (Koyna, en Inde, 1963). Plus que l’influence du poids de l’eau du réservoir, le phénomène principal est dû à la pénétration de l’eau en profondeur et à l’augmentation de la pression interstitielle dans des couches poreuses au voisinage d’un accident tectonique jusque-là inactif.Prévision des séismesL’étude de la sismicité régionale et le tracé des zones sismiques permettent de prévoir les régions où se produiront des séismes importants; l’étude systématique de la répartition des épicentres montre que, dans les grandes régions sismiques, des zones calmes (gap ) existent entre les zones d’activité récente: ce sont ces zones actuellement calmes qui présentent le plus de risques dans un avenir plus ou moins proche; leur surveillance par les différentes méthodes géophysiques est donc prioritaire.De vastes programmes de recherches ont été proposés dans plusieurs pays, Japon, États-Unis, Union soviétique, Chine: relevé des failles, enregistrement des déformations du sol, mesure des déplacements lents et continus (creep ) qu’on observe le long de certaines grandes failles de coulissage et qui peuvent atteindre quelques centimètres par an, révision périodique des polygones de nivellement, mesure du flux de chaleur, étude de la variation séculaire du champ magnétique terrestre et levés détaillés sur le terrain des composantes du champ, enregistrement des courants telluriques, mise en évidence d’anomalies de conductivité électrique.On a fondé beaucoup d’espoir dans l’enregistrement par des «réseaux de surveillance» (cf. supra : Microsismicité et séismes artificiels ) des faibles chocs pouvant constituer des signes prémonitoires d’un séisme plus important. En fait, un grand séisme n’est généralement pas précédé de telles secousses. Un exemple récent en a été fourni par le séisme du 29 février 1980, de magnitude 5, qui a entraîné des dégâts dans la zone épicentrale au voisinage d’Arudy (Pyrénées-Atlantiques): le réseau de surveillance installé dans les Pyrénées a, dans les mois qui ont précédé le séisme de 1980, enregistré de nombreux microchocs dans la région d’Arette où s’était produit le séisme destructeur du 13 août 1967, mais aucun dans celle d’Arudy, 25 kilomètres plus à l’est; c’est cette absence d’activité (gap ) qui aurait dû être prise en compte pour une prévision.Cependant, dans les rares cas où de nombreuses secousses prémonitoires faibles (essaims ) ont été enregistrées, une méthode de prévision fondée sur l’étude de la variation du rapport des vitesses des ondes P et des ondes S, variation due au phénomène de dilatance , a pu être expérimentée avec succès aux États-Unis en 1973.Aux méthodes classiques rappelées plus haut les Chinois ajoutent – grâce à la collaboration de plus de cent mille sismologues amateurs – l’observation de phénomènes précurseurs tels que bruits souterrains, comportement anormal des animaux (rats, serpents, oiseaux, chiens...), variations du niveau de l’eau dans certains puits, augmentation de la teneur en radon de l’eau de la nappe phréatique. Grâce à l’interprétation systématique et continue des données rassemblées, les sismologues chinois ont réussi la prévision spectaculaire du séisme (de magnitude 7,3) qui s’est produit dans la province de Liaoning le 4 février 1975: l’ordre d’alerte et d’évacuation a pu être donné 5 heures et 36 minutes avant le choc destructeur.Un an plus tard, malheureusement, la catastrophe du 27 juillet 1976 dans la région de Tangshan, faisant plus de 600 000 morts, est venue rappeler que le moment où l’on pourra formuler une prévision sûre et précise est encore fort éloigné. L’annonce, faite en 1980, que trois violents séismes devaient l’année suivante affecter dangereusement la région de Lima, au Pérou, ne s’est pas réalisée, mais a entretenu chez les habitants un sentiment d’angoisse généralisé et causé des pertes sensibles à l’économie nationale. Certains sismologues, aux États-Unis en particulier, se demandent aujourd’hui s’il est important de prévoir les séismes et si les accidents de circulation provoqués par la panique et l’évacuation de grandes cités ne causeraient pas plus de victimes que celles qui seraient dues au séisme lui-même; en ce qui concerne les dégâts matériels, le gain réalisé pourrait être annulé par les conséquences économiques qu’entraînerait l’évacuation des villes.Ainsi la seule mesure efficace reste aujourd’hui, et pour longtemps encore, le perfectionnement des constructions parasismiques et l’application stricte d’une réglementation de ces constructions.2. Les différents types de limites de plaquesDorsales océaniquesLe cas le plus simple est celui des dorsales océaniques. La sortie de matière chaude provenant de l’intérieur et son refroidissement engendrent des contraintes d’extension. Des failles normales sont disposées symétriquement par rapport à l’axe de la dorsale. La sismicité est superficielle et la magnitude n’excède pas 6.Dans quelques cas, les dorsales émergent (Djibouti, Islande). Il est alors possible de les étudier de près. Le réseau sismologique déployé dans la région de Djibouti a permis de connaître la sismicité dans cette zone et même d’étudier une crise sismique associée à une éruption fissurale.Dans d’autres cas, la croûte continentale n’est pas complètement séparée, le processus n’ayant pas encore abouti ou étant stoppé (fossé rhénan).Failles transformantesEn général on appelle failles transformantes les grands décrochements qui relient deux segments de dorsales ou deux régions de subduction. Elles correspondent aux limites de deux plaques où le déplacement relatif s’effectue parallèlement à la frontière commune. Des exemples caractéristiques sont fournis par la faille de San Andreas en Californie ou les failles d’El Pilar et de Boconó au Venezuela. La sismicité y est superficielle, ne dépassant pas une profondeur de 15 à 20 kilomètres, et elle indique bien que les surfaces de rupture sont plutôt verticales. Néanmoins, on peut trouver des situations plus complexes si la faille change de direction. C’est le cas de la faille de San Andreas, au nord de Los Angeles. Le changement de direction y produit un blocage de la faille et des contraintes de type compressif, responsables des tremblements de terre de San Fernando (1971, MS = 6,4) du côté ouest et de Kern County (1956, MS = 7,6) à l’est, mettant en jeu l’un et l’autre des failles inverses. Au contraire, si le changement se fait dans la direction opposée, le coulissage conservant le même sens le long de la faille, des pull-apart basins ou bassins en extension apparaissent, comme ceux qui sont connus le long de la faille de Boconó.Une autre source de complexité peut être trouvée en cas de ramification de la faille, comme cela se produit dans la région de San Francisco au nord de Hollister, ou bien lorsque la faille de Boconó se divise en trois branches au sud de Mérida, le mouvement total entre plaques étant alors distribué sur les différents éléments.Mais la propriété la plus remarquable concernant les grands séismes est qu’ils semblent avoir lieu d’une façon systématique et régulière sur les mêmes tronçons de la faille. C’est ainsi que la notion de tremblement de terre caractéristique devient importante dans les estimations du risque sismique.Convergence de plaquesConvergence océan-océanLe cas le plus simple de convergence entre plaques est celui de deux lithosphères océaniques. La sismicité permet de définir l’interface suivant laquelle s’effectue le déplacement (plan de Benioff). Pour ce type de convergence, l’angle de subduction est supérieur à 50 0. Dans quelques cas, la sismicité se présente sous forme de deux plans parallèles, l’un correspondant à l’interface proprement dite, l’autre étant situé à l’intérieur de la plaque plongeante. Les mécanismes au foyer varient le long de la subduction en profondeur, correspondant successivement à une déformation extensive due à la flexion de la plaque avant sa plongée près de la fosse, puis à la friction contre la plaque chevauchante, produisant des séismes de magnitude en général très élevée, et enfin aux effets gravitationnels de la plaque plongeant dans un milieu moins dense. Une activité sismique de faible profondeur est associée aux arcs insulaires [cf. ARCS INSULAIRES].Un exemple de convergence océan-océan est donné par la subduction caraïbe, où la plaque atlantique disparaît pour partie sous la plaque caraïbe. La vitesse de convergence varie suivant les auteurs entre 2 et 3,5 cm/an. Une lacune de sismicité développée depuis le dernier grand séisme de cette région en 1843 pourrait être le site d’un nouveau séisme de magnitude au moins égale à 8.Convergence océan-continentDans le cas de la convergence océan-continent, la situation est un peu plus complexe que dans le cas précédent. L’océan s’enfonce cette fois sous un continent plus léger, et le pendage de la subduction est en général moins accentué (de l’ordre de 450). Un cas typique est celui de la subduction de la plaque Nazca (Pacifique est) sous l’Amérique du Sud avec deux situations distinctes: d’une part, une subduction à angle normal, avec un volcanisme associé, d’autre part, une subduction présentant un pendage très faible, et sans volcanisme. La première correspond à la région du sud du Pérou (Arequipa), la seconde à la région du Pérou central, à la hauteur de Lima-Huancayo. La sismicité la plus importante se trouve au contact des deux plaques. Là ont lieu les grands tremblements de terre avec des fractures qui atteignent la surface, au niveau de la fosse. Une sismicité crustale se trouve associée à la formation des Andes, avec des failles normales le long de la flexure de la croûte continentale, et des failles inverses sur les flancs de la chaîne de montagne.Collision continent-continentIl n’y a pas de subduction dans le cas de la collision continent-continent, car la croûte continentale, plus légère, ne peut s’enfoncer dans le manteau. C’est la situation la plus complexe puisqu’il n’y a plus de limite de plaques linéaire où se concentre le mouvement relatif des plaques, mais au contraire la déformation s’étend sur de vastes régions, parfois à grande distance des ceintures ophiolitiques, témoins de l’ancienne croûte océanique qui séparait les plaques maintenant jointives. On parle ainsi de déformation plastique avec des failles inverses, des plis, des grands décrochements et des failles normales (cf. CHAÎNES DE MONTAGNES Typologie).Un exemple type est celui de la collision Europe-Afrique, contrôlée, selon Paul Tapponnier, par deux promontoires du continent africain: l’Arabie et l’Italie (fig. 6). L’Arabie agit comme un poinçon qui déforme l’Eurasie en formant la chaîne du Caucase et en éjectant latéralement l’Iran et la Turquie le long de la faille nord-anatolienne en décrochement dextre. De son côté, l’Italie s’écrase contre l’Europe le long des Alpes et contribue à la formation des Carpates. Le comportement en poinçon ou en écrasement dépend du sens de la subduction qui a précédé la collision. La croûte qui se déforme le plus est celle qui a les propriétés mécaniques les moins rigides du fait de la chaleur produite par la friction au contact des deux plaques s’affrontant, donc celle sous laquelle est dirigée la subduction avant la collision. Dans le cas de l’affrontement Europe-Afrique, une partie de la convergence reste océanique (l’arc égéen), mais la plupart des éléments tectoniques sont caractéristiques de la collision continentale. La sismicité est distribuée tout autour de la Méditerranée. Il n’y a pas de séisme dépassant une magnitude de 7,5 d’après les données historiques.Des exemples de la multiplicité des failles mises en jeu au cours de cette collision peuvent être trouvés au sud de l’Espagne et en Afrique du Nord, avec des plis, des failles inverses, normales ou en décrochement, mais le tout compatible avec des contraintes régionales ayant un axe de compression nord-nord-ouest - sud-sud-est. C’est dans cette région que s’est produit le séisme d’El-Asnam (1980, MS = 7,3), provoqué par le rejeu d’une faille inverse présentant une composante décrochante.3. La source sismiqueUn sismogramme porte essentiellement deux types d’informations liés l’un à la propagation des ondes sismiques du foyer au point d’observation, l’autre au processus de rupture à la source sismique. Celle-ci est étudiée maintenant activement pour comprendre comment les séismes se développent, pour estimer les mouvements forts au voisinage du foyer et pour fixer les normes de réalisation des habitations et constructions à haut risque (barrages, centrales nucléaires).Les tremblements de terre se produisent dans la partie fragile de la lithosphère. Le modèle de rebondissement élastique de H. F. Reid, construit à partir des observations géodésiques avant et après le séisme de San Francisco en 1906, est maintenant généralement admis: le mouvement relatif de deux plaques lithosphériques entraîne une déformation lente à faible distance de leur frontière avec accumulation continue de contraintes au niveau de la surface de contact qui cédera brutalement lorsque ces contraintes dépasseront la limite de résistance à la rupture des matériaux. Les données géodésiques permettent également de constater qu’en profondeur les matériaux fluent, concentrant les contraintes tectoniques dans la partie supérieure cassante de la croûte terrestre. Au cours d’un tremblement de terre, c’est donc seulement une zone superficielle très peu épaisse qui glisse de façon discontinue, l’ensemble de la Terre réagissant élastiquement. Il paraît aussi bien acquis que ce sont les parties affaiblies par des fractures anciennes qui vont rejouer préférentiellement.Si les causes des séismes sont assez bien expliquées pour leur plus grande part par la tectonique des plaques, le mécanisme de la rupture est encore l’objet de recherches très actives. Le faible nombre de données, particulièrement en champ proche, impose de modéliser la source sismique avec des modèles très simples dépendant d’un petit nombre de paramètres.On considère que les processus anélastiques ne concernent qu’une zone réduite autour du foyer et que la radiation des ondes sismiques résulte des contraintes équivalentes nécessaires pour produire les déformations dans les zones, extérieures à la source, où les lois de l’élasticité sont vérifiées: on appelle densité de moment sismique le tenseur des contraintes équivalent. Les sismologues utilisent généralement un modèle de double couple sans moment pour caractériser les sources sismiques. Dans la plupart des applications, l’approximation d’une source ponctuelle est suffisante, surtout lorsqu’on s’intéresse à des périodes de quelques secondes ou dizaines de secondes.Pour expliquer les observations sismiques, les sismologues introduisent des modèles simples. Dans le modèle de boucle de dislocation, le séisme est simulé par une discontinuité du déplacement de part et d’autre d’un plan de faille et sur une surface géométriquement simple (rectangle ou cercle). C’est un modèle essentiellement cinématique, où la dynamique de la rupture est négligée et où n’intervient que l’évolution dans le temps du glissement. Cette solution est incompatible avec la mécanique des milieux continus puisqu’il y a pénétration de la matière sur les bords de la surface de dislocation.Aussi les modèles dynamiques commencent-ils à être développés en s’appuyant sur la mécanique de la rupture des roches: une fissure en cisaillement se propage à partir d’un noyau, à relativement grande vitesse, en libérant les contraintes exercées sur la surface jusqu’à une valeur résiduelle, la friction. La fracturation se poursuit lorsque la contrainte en bout de fissure dépasse un niveau fixé suivant un critère objectif: on considère que l’énergie accumulée élastiquement doit être au moins égale à celle qui est nécessaire à la création de nouvelles surfaces. Dans un milieu homogène, uniformément contraint, la fissure se propage indéfiniment. Il faut un mécanisme d’arrêt, par exemple l’existence d’hétérogénéités locales de la résistance à la rupture du matériau (barrières) ou du champ de contrainte (aspérités). L’arrêt brutal de la rupture engendre de fortes ondes sismiques à l’intérieur de la fissure qui vont stopper le développement du glissement. Comme le jeu d’une faille se fait sous forte contrainte normale en compression, la friction va empêcher l’inversion de sens du glissement qui pourra se faire par saccades successives.L’hétérogénéité introduite pour stopper la rupture dans ces modèles de sources dynamiques permet d’expliquer la complexité observée sur les sismogrammes des grands séismes ou celle de la distribution spatiale des répliques localisées avec précision par des réseaux portables de sismomètres installés après des chocs majeurs: le tremblement de terre d’El-Asnam le 10 octobre 1980 est l’exemple d’un séisme complexe comprenant une succession de trois chocs, affectant des parties différentes de la faille. Keiiti Aki a proposé un modèle avec des zones à plus grande résistance à la rupture appelées barrières. Lorsque le front de rupture atteint cette barrière, la vitesse de propagation est ralentie ou même annulée, la rupture pouvant reprendre au-delà, laissant intacte une partie de la faille qui pourra céder lors de répliques ultérieures. Hiroo Kanamori a introduit un modèle avec des aspérités, les zones où se concentrent les contraintes dues à des séismes antérieurs ou à un glissement asismique (fluage par exemple). On peut considérer aussi un modèle mixte à partir de ces deux types de base. Ces modèles permettent d’expliquer pourquoi le relâchement des contraintes observé après les séismes est si faible (10 à 100 bars), alors que les mesures de laboratoires conduisent à des valeurs dépassant 1 kilobar pour obtenir la fracturation. La chute de contrainte mesurée par les sismologues serait une moyenne calculée sur l’intégralité de la faille et non pas sur les zones significatives considérées dans les modèles avec barrières ou aspérités. Trop peu de données sont actuellement disponibles pour permettre de progresser plus rapidement dans la compréhension du mécanisme des processus à la source des séismes. Des réseaux plus nombreux de sismomètres et d’accéléromètres (appareil de mesure des mouvements forts dans les zones sismiques) sont indispensables pour progresser dans la prévention et la prévision des séismes.
Encyclopédie Universelle. 2012.
